Avec «Le Grand Monde», l’auteur d’«Au revoir là-haut» inaugure une nouvelle et formidable fresque dédiée aux Trente glorieuses. Le Temps a rencontré un marathonien du roman. Et j’ai aimé. L’auteur, le livre, l’interview.

Dans le clair-obscur façon commissaire Maigret d’un grand hôtel genevois, Pierre Lemaiftre vous raconte comment il doit tout à Au revoir là-haut, Prix Goncourt en 2014: la notoriété, l’argent, la liberté d’échafauder des cathédrales romanesques. Le Grand Monde ouvre une tétralogie dont les Trente Glorieuses sont le théâtre et la guerre d’Indochine le premier acte.
Il commande un Lagavulin 16 ans, on le suit et on plonge avec lui dans le Grand Monde, cet établissement de Saigon qui est un chaudron où bouillent, dans la même huile, affairistes, courtisanes, légionnaires. Cette galerie de tordus est celle d’une opérette avec ses refrains burlesques, ses coups de théâtre, ses changements de vitesse haletants. Pierre Lemaitre orchestre leurs chants sans jamais perdre haleine. Ce coureur lent n’a pas enchaîné les marathons pendant trente ans sans en garder le vice. La jouissance du second souffle.
Le Temps: Pourquoi installer votre théâtre au cœur des Trente glorieuses?
Pierre Lemaitre: C’est mon époque. Je suis né avec, en 1951, quand au désenchantement de l’après-guerre succède une forme d’euphorie. On est dans l’ascenseur social. On achète son appartement, une Dauphine, un poste de télévision en noir et blanc. Mais c’est le cliché. Si on le gratte, on rencontre l’abbé Pierre, les bidonvilles, les habitants qu’on chasse pour pouvoir construire les périphériques. Le stéréotype dit en partie vrai, mais cache les coulisses de la prospérité: le bien-être masque le mal-être.
«Le Grand Monde» met en lumière l’année 1948 et la guerre d’Indochine. Eric Vuillard publie ce printemps un roman – «Une Sortie honorable» – qui exhume cette période. Etait-elle refoulée?
Je dirais plutôt qu’elle était oubliée. Elle était lointaine et on l’a mise à distance, au point qu’elle s’est diluée dans les mémoires, contrairement à la guerre d’Algérie, qui était une guerre de conscription. En Indochine, seuls les militaires de carrière ont combattu. Elle n’a intéressé en métropole que ceux qui avaient de l’argent à placer et à gagner là-bas. Car ce conflit correspond aussi à l’acmé d’un certain capitalisme français.
Le grand sujet de vos romans, c’est la corruptibilité des êtres et du système. Pourquoi cette obsession?
La corruption est inhérente au capitalisme pour des raisons simples et mécaniques. Il privilégie la rentabilité à court terme, le circuit rapide. C’est ce qui se passe à ce moment-là en Indochine. Il n’y a pas plus juteux que la prévarication.
A vous lire, l’état de nos démocraties est inquiétant. Qu’y a-t-il à sauver?
Il y a un idéal qui résiste dont certains de mes personnages sont porteurs: François Pelletier a une conception de la presse, son frère Etienne est animé par l’amour. Je critique le capitalisme et ses ravages, mais je ne désespère pas de l’homme. Je ne suis pas un auteur pessimiste.
Qu’est-ce qu’un personnage réussi?
C’est une figure ambiguë que le lecteur peut détester à des moments, aimer à d’autres. Dans ce roman, Jean est un serial killerépouvantable, mais aussi un fils et un mari pathétique. On le condamne, mais il vous touche quand même. De toute façon, si un personnage n’est pas à la hauteur, je le licencie sec!
Dans votre trilogie «Les Enfants du désastre», vous couvriez la période allant de 1914 à 1945. La tétralogie que vous ouvrez embrasse les trois décennies suivantes. Qu’est-ce que l’histoire apporte au romancier?
Je me sers de l’histoire comme d’un instrument, je n’ai pas de réflexion historique. Je l’utilise pour essayer de comprendre le monde. Très prosaïquement, j’écris sur mon siècle, le XXe qui a commencé avec la Première Guerre mondiale et s’est terminé avec la chute du Mur en 1989. Je ne raconte pas le siècle, je feuillette un album de photographies, la période pendant laquelle j’ai été fabriqué.
Quel est l’auteur que vous enviez?
Je pourrais citer l’Américain John Dos Passos et sa trilogie USA.Mais celui que je jalouse, c’est Emile Zola. Je suis fasciné par la page manuscrite où, vers 1868, il établit la liste des vingt livres qui vont composer Les Rougon-Macquart. Il pose les titres, se donne vingt ans pour les écrire et réalise son dessein en vingt-deux ans. La puissance de conceptualisation que cela suppose me dévaste!
Elle ne vous est pas étrangère pourtant, avec votre tétralogie…
Mais non! Je suis un besogneux, je fais mon petit ouvrage pas à pas, livre après livre. Et je fabrique la théorie a posteriori. Zola, Victor Hugo, Alexandre Dumas sont des héros de la conceptualisation, leur puissance n’a pas d’équivalent. Je suis baba devant Hugo, sa capacité de suivre le fil de son récit et d’embarquer le lecteur dans des diversions qui finissent toujours par ramener au cœur de l’histoire.
Vos personnages sont souvent des petites gens. Est-ce un parti pris politique?
J’écris pour les concierges et j’écris sur les concierges. Ce que je veux dire, pour faire court, c’est que j’écris sur la classe dont je suis issu pour la classe dont je viens. Mon boulot est d’essayer d’être un témoin loyal entre l’Histoire et mon histoire.
Le roman est-il une forme de consolation pour le lecteur?
Je déteste la notion du roman qui vous fait du bien. Mais si la vie était suffisante, il n’existerait pas. De ce point de vue, il offre une forme de consolation. C’est parce que la vie n’assouvit pas nos aspirations que la littérature a son utilité.
«Le Grand Monde» emprunte au feuilleton sa nervosité. Comment définiriez-vous un roman populaire?
J’aime bien l’image de l’opérette, ce genre qui dit des choses en apparence superficielles et sottes, mais très vraies au fond. Je revendique cette culture-là, celle aussi des chansons populaires.
Quand savez-vous à coup sûr que le roman est achevé?
Je sais au départ qu’il fera 580 pages, c’est mon format depuis Au revoir là-haut, qui ouvrait la trilogie Les Enfants du désastre. J’ai été marathonien: je sais ce que c’est que de courir 42 kilomètres et 195 mètres. Mais arrive le moment de l’épuisement. Je donne une première version à mon premier cercle, mon épouse et mon agent. Je fais une deuxième version, puis une troisième que je soumets à mon éditeur. Je prends en compte ses remarques et fais une quatrième mouture. Et puis là, j’arrête! J’ai travaillé dix-huit mois sur le livre, j’ai pensé jour et nuit aux personnages, j’en ai rêvé. Il faut admettre que la ligne d’arrivée est franchie.
Quand avez-vous su que vous seriez écrivain?
Je l’ai toujours su. Vers l’âge de 11 ans, avec mon copain Pelletier, nous avons décidé d’écrire un roman. Nous n’avons écrit que deux pages, mais c’était inaugural. La littérature n’avait pas de concurrent à mon époque. Dès que j’ai vécu mes premiers enthousiasmes de lecteur, j’ai eu la certitude que c’était cela que je devais faire. Après, comme je suis un homme lent et tardif, j’ai attendu l’âge de 56 ans pour publier.
Qu’est-ce qui fait de vous un écrivain?
Tout ce que je vois, tout ce que je vis se transforme en fiction. Je ne peux pas faire autrement.
Le style pour vous, c’est quoi au fond?
Pierre Assouline demande à Georges Simenon, dont il a été le biographe: «C’est quoi votre style?» Simenon répond: «Il pleut.» Je suis un styliste sur ce plan-là. Le journaliste Jérôme Garcin a dit un jour quelque chose sur moi que je trouve juste: «Lemaitre a une écriture modeste». Je viens de cette classe-là, j’ai un rapport à la littérature qui est un rapport modeste.
Quel est le livre qui a changé votre vie?
Les Misérables d’Hugo, Les Trois Mousquetaires, Vingt ans après et Le Vicomte de Bragelonne d’Alexandre Dumas et A la recherche du temps perdu de Proust. J’ai senti qu’à partir de ces lectures ma vie prenait une autre direction et que ma vision du monde changeait.
Quelle vision au juste?
Avec Dumas, j’ai compris qu’une pensée abstraite pouvait s’incarner dans une action. Avec Proust, qu’on ne connaissait jamais le fin mot de l’histoire et qu’il était toujours possible d’aller plus loin dans la compréhension de la psyché. Avec Hugo, que la littérature pouvait empoigner le monde.
Pierre Lemaitre, «Le Grand Monde». Roman, Calmann-Lévy, 592 p.
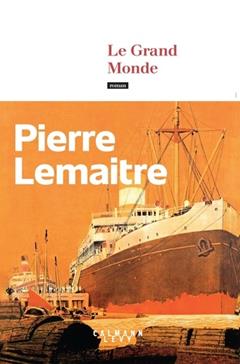
J’adore Pierre Lemaitre, j’espère que je ne serais pas déçu par celui-ci ! Super boulot ton blog, vraiment 👌 hésites pas à venir faire un tour sur mon site Intel-blog.fr et à t’abonner si ça te plaît 🙂
J’aimeJ’aime